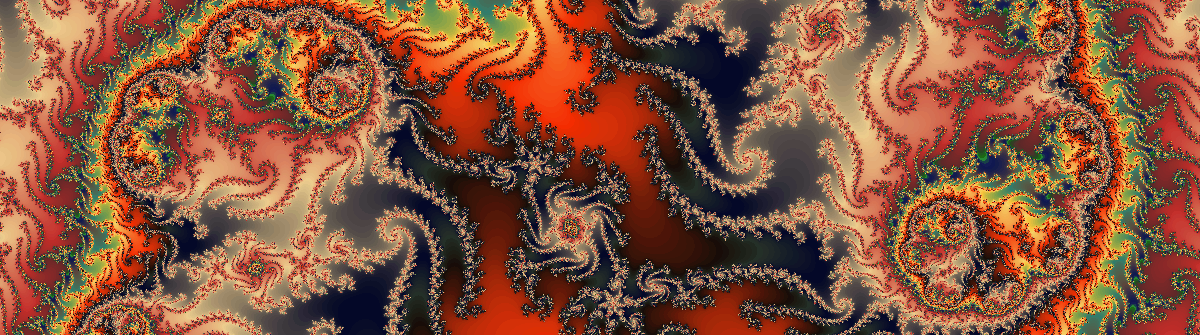Digital Humanities et Philosophie fractaliste
L'expression anglo-américaine "Digital Humanities" – en français : Humanités Digitales (numériques) –, désigne l'ensemble des sciences humaines et sociales, des arts de toute nature (de l'Antiquité à nos jours) et des lettres (créations littéraires et théâtrales), en tant que ces champs de pensée créatrice, de recherche et d'activité culturelle sont aujourd'hui impliqués par les technologies numériques de l'information et de la communication. La numérisation massive des données (textes anciens, manuscrits, livres, publications officielles ou "littérature grise", musique, films cinématographiques, vidéos, photographies d'œuvres d'art et d'architecture, etc.), leur diffusion en ligne, mais aussi le traitement numérique comparatif de ces données les plus variées, font partie du domaine en expansion continue des Digital Humanities du vingt-et-unième siècle. Les Digital Humanities défendent aussi un esprit participatif et collaboratif entre tous les acteurs du savoir numérisé en réseau, et entre toutes les branches du savoir : sciences humaines et sociales, arts et littéraure, sciences physiques et mathématiques, médecine et sciences de la vie, etc., mais également entre et avec tous ceux qui veulent apporter leur concours au développement des "humanités digitales", qu'ils soient ou non des spécialistes "académiques" (consacrés institutionnellement) de telle ou telle discipline universitaire, car les Digital Humanities rendent les savoirs de toute nature partageables et réappropriables par tous. Cf. site → Digital Humanities
Apprendre, philosopher, avec les outils numériques
De l'écriture sur tablettes d'argile aux tablettes tactiles numériques
Lorsque des innovations techniques majeures pour l’évolution culturelle, impactent le champ traditionnel de la connaissance et de la transmission des savoirs, il est habituel qu’elles soulèvent plus d’opposition et de résistance que l’acceptation enthousiaste, en particulier de la part des « lettrés » et des universitaires. L’histoire n’est pas nouvelle : l’invention de l’écriture sur des tablettes d'argile – en Mésopotamie vers 3400 ans avant  notre ère, à la fin de la Préhistoire –, sans doute la plus puissante de toutes puisqu’elle rendit possible l’inscription durable et réutilisable à volonté d’informations de toute nature, ainsi que les opérations comptables, l’organisation et la gestion codifiée des sociétés et, plus généralement, la maîtrise planifiée de l’histoire humaine, fut dès l’Antiquité grecque la cible de critiques philosophiques virulentes, dans la mesure où elle bouleversa radicalement l’apprentissage des savoirs. La transmission orale, mémoire vive, dut céder le pas irréversiblement devant la transmission écrite, ce que Platon considérait dans le Phèdre (274d-275b) comme une offense au « vrai » savoir, celui qui fait révérence à la tradition orale, à l’ancestralité de la transmission verbale, plus proche de l’esprit de vérité que l’écrit qui, selon le philosophe athénien, rendrait l’être humain oublieux en encourageant la paresse intellectuelle. L’origine mythique de l’écriture exposée par Platon dans le Phèdre, rapporte celle-ci au dieu égyptien Theuth, inventeur des premiers caractères de l’écriture et des sciences qui reposent sur elle. Ce dernier défendit l’enseignement et la diffusion de l’écriture au nom de l’accroissement bénéfique du savoir par le développement de la mémoire artificielle de l’humanité. L’écriture apparaît donc – ce qu’elle est en réalité – comme une « technique objective » de la mémoire, une mnémotechnie efficace, qui permet de la faire s’accroître indéfiniment, à l’opposé (et indépendamment) de la faiblesse temporelle de la mémoire subjective. Or, lorsque Theuth présenta sa superbe et puissante invention au divin roi Thamous, celui-ci lui exprima son extrême méfiance à l’égard de l’écriture, car les hommes, par cette invention pour ainsi dire « diabolique », s’en remettront désormais à cette technique d’extériorisation de la pensée qui les dispensera d’activer leur vivante mémoire : l’écriture rendra peu à peu les hommes oublieux… [↑ Image ci-dessus : Caractères d'écriture cunéiforme sur tablette d'argile, vers 3400-3500 av. J.-C., Sumer, Mésopotamie.]
notre ère, à la fin de la Préhistoire –, sans doute la plus puissante de toutes puisqu’elle rendit possible l’inscription durable et réutilisable à volonté d’informations de toute nature, ainsi que les opérations comptables, l’organisation et la gestion codifiée des sociétés et, plus généralement, la maîtrise planifiée de l’histoire humaine, fut dès l’Antiquité grecque la cible de critiques philosophiques virulentes, dans la mesure où elle bouleversa radicalement l’apprentissage des savoirs. La transmission orale, mémoire vive, dut céder le pas irréversiblement devant la transmission écrite, ce que Platon considérait dans le Phèdre (274d-275b) comme une offense au « vrai » savoir, celui qui fait révérence à la tradition orale, à l’ancestralité de la transmission verbale, plus proche de l’esprit de vérité que l’écrit qui, selon le philosophe athénien, rendrait l’être humain oublieux en encourageant la paresse intellectuelle. L’origine mythique de l’écriture exposée par Platon dans le Phèdre, rapporte celle-ci au dieu égyptien Theuth, inventeur des premiers caractères de l’écriture et des sciences qui reposent sur elle. Ce dernier défendit l’enseignement et la diffusion de l’écriture au nom de l’accroissement bénéfique du savoir par le développement de la mémoire artificielle de l’humanité. L’écriture apparaît donc – ce qu’elle est en réalité – comme une « technique objective » de la mémoire, une mnémotechnie efficace, qui permet de la faire s’accroître indéfiniment, à l’opposé (et indépendamment) de la faiblesse temporelle de la mémoire subjective. Or, lorsque Theuth présenta sa superbe et puissante invention au divin roi Thamous, celui-ci lui exprima son extrême méfiance à l’égard de l’écriture, car les hommes, par cette invention pour ainsi dire « diabolique », s’en remettront désormais à cette technique d’extériorisation de la pensée qui les dispensera d’activer leur vivante mémoire : l’écriture rendra peu à peu les hommes oublieux… [↑ Image ci-dessus : Caractères d'écriture cunéiforme sur tablette d'argile, vers 3400-3500 av. J.-C., Sumer, Mésopotamie.]
Dix-neuf siècles après Platon, à la critique des présumés ravages provoqués par l’écriture manuscrite sur la mémoire vivante, succéda la critique de la typographie : l’impression mécanique des textes sur papier, au moyen de caractères mobiles, enlevait au geste appliqué du scribe ses ancestrales prérogatives. L’invention des folios i mprimés recto-verso, vers le milieu du quinzième siècle, fut certes précédée du codex manuscrit, énorme progrès par rapport au volumen antique, puisque le codex introduisait la notion de « pages » distinctes, reliées entre elles mais séparées, à l’origine d’une lecture discontinue et sélective des textes ainsi que des images (enluminures, illustrations) qui les accompagnaient. Mais l’invention en Europe, par Johannes Gutenberg (vers 1400-1468), des techniques typographiques, notamment l’usage de caractères métalliques standardisés et mobiles (« types »), associé à l’impression xylographique des gravures – les Chinois avaient, cependant, inventé l’imprimerie à caractères mobiles dès le onzième siècle –, marquera une étape culturelle capitale vers la multiplication et la diffusion massive des connaissances (textes et images) et aussi de l’art littéraire ; d’ailleurs, l’invention du roman moderne, qui fit florès et ne cessa d’amplifier ses productions jusqu’à la surmultiplication que l’on connaît aujourd’hui, est l’une des conséquences majeures de l’invention des nouveaux codex typographiés.
mprimés recto-verso, vers le milieu du quinzième siècle, fut certes précédée du codex manuscrit, énorme progrès par rapport au volumen antique, puisque le codex introduisait la notion de « pages » distinctes, reliées entre elles mais séparées, à l’origine d’une lecture discontinue et sélective des textes ainsi que des images (enluminures, illustrations) qui les accompagnaient. Mais l’invention en Europe, par Johannes Gutenberg (vers 1400-1468), des techniques typographiques, notamment l’usage de caractères métalliques standardisés et mobiles (« types »), associé à l’impression xylographique des gravures – les Chinois avaient, cependant, inventé l’imprimerie à caractères mobiles dès le onzième siècle –, marquera une étape culturelle capitale vers la multiplication et la diffusion massive des connaissances (textes et images) et aussi de l’art littéraire ; d’ailleurs, l’invention du roman moderne, qui fit florès et ne cessa d’amplifier ses productions jusqu’à la surmultiplication que l’on connaît aujourd’hui, est l’une des conséquences majeures de l’invention des nouveaux codex typographiés.
[↑ Image ci-dessus : Chroniques de Nuremberg (Liber chronicarum, f 223r) par Hartmann Schedel. Incunable, 1493, Feuillet imprimé et illustré. Source : Wikipedia.]
À l’époque de Gutenberg, la mécanicité de l’impression et, surtout, la reproductibilité sérielle illimitée des livres, étaient jugées pernicieuses par les sectateurs de l’écriture manuscrite singulière des scribes du Moyen-Âge, au sein de leurs scriptoria. Car les incunables étaient principalement des ouvrages concernant la religion et la théologie ; ils étaient donc réputés susceptibles d’encourager la lecture critique individuelle, rationnelle et surtout comparative, donc potentiellement subversive, des Saintes Écritures. En outre, le livre imprimé à une grande quantité d’exemplaires autorise la diffusion des connaissances scientifiques dans le corps social, infiniment mieux que ne pouvaient – et que ne voulaient – le faire les rédacteurs de manuscrits réservés à une classe de privilégiés : des clercs (gens instruits, présumés « savants » ou « lettrés ») qui appartenaient en majorité au sérail ecclésiastique. Cette fonction culturelle collective était estimée comme le ferment le plus dangereux de la critique « instruite » des idées religieuses et des pouvoirs politiques. – Or, c’est à un ouragan culturel et philosophique comparable, mais beaucoup plus violent car plus global – mondial à terme, quand certains pays encore peu industrialisés auront rattrapé tout leur retard technologique –, que nous exposent depuis les années 1990-2000 les outils de mémorisation et de  diffusion numériques des savoirs. Ordinateurs, tablettes-PC tactiles, liseuses numériques (« ebooks »), télévision numérique raccordée aux réseaux informationnels, et aussi téléphones multimédias reliés à l’Internet (« Smartphones »), sont autant de moyens technologiques de critique et de subversion cognitive des moyens traditionnels, scolaires et universitaires, d’acquisition, de diffusion et de transformation des savoirs, dans tous les domaines des sciences et de la culture. Ces domaines, au demeurant assez cloisonnés – surtout dans le système universitaire français –, étaient jusqu’alors réservés en priorité aux bénéficiaires de l’instruction universitaire, aux « lettrés », aux spécialistes, … bref, aux experts de tout poil qui considéraient leur domaine d’étude et de recherche comme un « patrimoine » non divulgable sans une patiente initiation qui passait, généralement, par le luxuriant relais des livres imprimés qui alimentaient le commerce de l’édition.
diffusion numériques des savoirs. Ordinateurs, tablettes-PC tactiles, liseuses numériques (« ebooks »), télévision numérique raccordée aux réseaux informationnels, et aussi téléphones multimédias reliés à l’Internet (« Smartphones »), sont autant de moyens technologiques de critique et de subversion cognitive des moyens traditionnels, scolaires et universitaires, d’acquisition, de diffusion et de transformation des savoirs, dans tous les domaines des sciences et de la culture. Ces domaines, au demeurant assez cloisonnés – surtout dans le système universitaire français –, étaient jusqu’alors réservés en priorité aux bénéficiaires de l’instruction universitaire, aux « lettrés », aux spécialistes, … bref, aux experts de tout poil qui considéraient leur domaine d’étude et de recherche comme un « patrimoine » non divulgable sans une patiente initiation qui passait, généralement, par le luxuriant relais des livres imprimés qui alimentaient le commerce de l’édition.
[↑ Image ci-dessus : Tablette tactile numérique. La page du blog mise en abyme.]
Compétences académiques contre savoirs métissés en réseau
Cette situation d’inégalité culturelle par laquelle était présumé « incompétent » celui qui n’avait pas réussi à obtenir les grades académiques, au terme des cursus orthodoxes des écoles, « grandes » ou petites, et des universités, avec pour socle de formation obligé le livre en papier et la linéarité de la lecture et des apprentissages, s’est propagée depuis l’invention de la typographie et la lecture linéaire des livres imprimés en série. La « présomption d’incompétence » : expression employée par Michel Serres qui a si intelligemment compris, depuis bien longtemps, les bouleversements révolutionnaires de l’enseignement scolaire et universitaire – hélas trop souvent conventionnel, passéiste ou calcifié –, apportés par le croisement multidimensionnel et le métissage inventif des champs intellectuels, favorisé par la mise en réseau des savoirs[1]. L’autorité intellectuelle traditionnelle (le mot « autorité » est déjà par lui-même suspect en matière de savoir et de compétence…) reposait sur le livre et sur ceux qui, officiellement – c’est-à-dire au nom d’un grade académique, d’un diplôme, d’un cursus, d’une institution universitaire, etc. –, s’en faisaient les simples porte-voix. Le temps des maîtres est révolu ; le rapport hiérarchique traditionnel entre apprenant et professeur se voit aujourd’hui radicalement bouleversé par le développement, inéluctable et salutaire à cet égard, des technologies numériques d’édition et de diffusion en réseau des savoirs. Qu’elles le souhaitent ou, au contraire, ne veuillent pas y succomber pour d’autres motifs que les seules pratiques gestionnaires et administratives, l’université et l’école devront s’adapter à ces technologies de l’information et de la communication, car les étudiants et les élèves, utilisateurs quotidiens aguerris de ces technologies, conduiront bon gré mal gré leurs enseignants – dont les fonctions et les missions seront à redéfinir intégralement – à réviser leurs méthodes et leurs sources pédagogiques en conséquence.
Constatons, au passage, qu’aucun gouvernement ou ministère français de l’éducation ou des universités, n’a été suffisamment clairvoyant et inventif, jusqu’à présent, pour accepter de prendre à bras le corps cette question de la transformation des métiers de l’enseignement sous l’influence des technologies informationnelles. Ainsi, les ordinateurs et le multimédia en réseau sont toujours fort peu utilisés, en général, comme de véritables outils pédagogiques « ouverts », susceptibles de remanier en profondeur non seulement les méthodes et les « contenus », c’est-à-dire les savoirs, mais aussi et surtout les rapports entre enseignants et enseignés, ces derniers étant depuis longtemps de plain-pied avec le monde des réseaux et du multimédia, pratique qui devrait logiquement conduire à une remise en cause de la transmission orale unidirectionnelle, et de l’ancienne fonction de « porte-voix », de faire-valoir des connaissances déposées dans les livres. L’enseignement et l’apprentissage de la philosophie en bénéficieraient d’ailleurs au tout premier plan – j’ai publié à ce sujet, en 1999, un essai (entièrement d’actualité) qui examinait en détail les tenants et aboutissants de la philosophie universitaire confrontée aux technologies numériques, intitulé Philosophie et Société de l’information[2], bien avant d’ailleurs que les philosophes universitaires n’aient commencé à prendre conscience sérieusement de l’impact pédagogique révolutionnaire, à long terme, des technologies de l’information et de l’Internet. Pour s’inventer, la philosophie doit aussi accepter de se métisser, de se croiser de manière multidirectionnelle, dynamique, avec toutes les sortes de savoirs, mais aussi de pseudo ou simili-savoirs. – Quels sont donc, en bref, les renversements de points de vue engendrés ou encouragés par ces technologies informationnelles ?
La possibilité d’accéder rapidement à une énorme quantité d’informations, en croissance continue, par l’hyper-réseau mondial qu’est l’Internet, et par les outils les plus quotidiens – notamment les téléphones portables, les tablettes tactiles et les ordinateurs –, apparaît souvent comme un handicap aux yeux de la philosophie universitaire académique. Elle n’y voit, en effet, que l’occasion d’acquérir un pseudo-savoir d’ordre strictement cumulatif, sans aucun rapport avec un authentique savoir constitué, et cette perspective consternante lui procure une angoisse incoercible, qui s’ajoute à l’inquiétude, généralement partagée, relative aux problèmes que connaît l’enseignement de la philosophie sous sa forme traditionnelle, essentiellement « universalisante », appuyée sur les grands thèmes de l’histoire de la philosophie occidentale. Car, si les programmes de philosophie de la classe terminale des lycées ne sont pas du tout inféodés à l’histoire des doctrines, s’ils sont même présentés essentiellement comme des listes de thèmes et de notions indépendants de l’histoire des doctrines, il n’empêche qu’ils sont inspirés en majorité de concepts et de champs thématiques qui ont été abondamment débattus par les philosophes consacrés, depuis Platon[3]. C’est pourquoi, bien que l’histoire de la philosophie en tant qu’enseignement distinct y soit devenue minoritaire, elle est en réalité omniprésente au sein même de la pensée autoconstitutive du professeur de philosophie dans sa classe, lequel endosse, pour ainsi dire, la démarche idéalisante de ses illustres devanciers.
Le reproche adressé à l’Internet concernant le soi-disant « trop-plein » d’information, concomitant de l’absence totale de savoir, recouvre en réalité une difficulté majeure de l’esprit de l’enseignement philosophique français : son impuissance à utiliser les informations multimédiatiques autrement qu’à titre de connaissances ponctuelles, sans lien entre elles, incohérentes et parfois incertaines, car leur source, à juste titre d’ailleurs en certains cas, est suspectée d’être sujette à caution. Dans ces conditions, comment la réflexion philosophique pourrait-elle en faire un usage profitable et pertinent ? La cause des technologies informationnelles dans l’enseignement philosophique paraît en somme perdue d’avance. Sans parler des craintes de subversion de la singularité inaliénable de l’être humain, sous l’effet de l’uniformisation des technologies numériques qui sont le moyen obligé de la diffusion massive de l’information, réduite aux chiffres binaires (0 et 1) du langage booléen. De la réduction binaire de l’information à la normalisation identitaire de l’individu, il n’y a qu’un pas vite franchi par l’imagination pessimiste du philosophe allergique à l’introduction de la « société de l’information » dans l’enceinte de l’école et de l’université.
Pourtant, les arguments pusillanimes qui voudraient faire croire à l’indignité de l’Internet utilisé dans le cadre des recherches et des enseignements philosophiques universitaires, oublient que la sphère philosophique tout entière se nourrit de l’information extraphilosophique depuis ses origines. La conceptualisation est toujours un aboutissement, jamais un commencement, sauf à vouloir restreindre le champ de la pensée philosophique à une sorte de cercle fermé au sein duquel les concepts se feraient écho entre eux, à la manière d’une boucle récursive purement rhétorique et donc parfaitement stérile. Ces arguments omettent, en particulier, que le pouvoir critique de la réflexion philosophique démystifiante ne peut s’exercer que sur le terreau de l’information extérieure au champ institutionnel de la philosophie, et qu’il faut d’abord mettre en ordre l’information inhomogène, complexe, pour aboutir à une forme de spéculation désintéressée mais en incidence sur le réel, car le « réel », pour le philosophe autant que pour n’importe quel individu doué d’intelligence et de sensibilité, c’est inéluctablement le réel déjà exprimé par les mots, les images, les sons. C’est donc un réel qui se présente à l’état d’information.
Se plaindre de l’inflation anarchique, de l’incoordination et de l’hétérogénéité des données informationnelles qui circulent sur l’hyper-réseau mondial, sans chercher à s’en emparer, revient tout bonnement à laisser régner la peur irraisonnée de la prétendue tyrannie de l’informatisation universelle et subversive de l’information, qui nierait la liberté de penser et soumettrait l’individu à l’emprise de la désinformation. On peut craindre aussi, selon un point de vue cognitif, que l’excès d’information n’engendre plus que du « bruit » au sens de la théorie mathématique de l’information, c’est-à-dire une sorte de magma entropique de données désordonnées, mal déchiffrables et inexploitables, inaptes à produire du savoir. Aussi la solution courageuse que sera amenée à adopter la réflexion philosophique afin de neutraliser cette méfiance excessive à l’égard de l’univers informationnel, en luttant aussi bien contre la surinformation qui assourdit — car purement entropique — que contre la désinformation mystificatrice, mais aussi pour sortir du ghetto de l’autoréférence conceptuelle, c’est bien celle de « l’adaptation » critique à tous les types de contenus véhiculés sur l’Internet.
Vers une philosophie fractaliste hypermédiatique
La méthode philanalytique transdisciplinaire est fort heureusement plus ambitieuse que cela. Il s’agit, bien plutôt, de se servir sélectivement de fragments documentaires en tout genre – textes, images, séquences sonores, documents audiovisuels –, éventuellement classés sur l’Internet dans des rubriques informationnelles hétérogènes, évalués sans complaisance et choisis pour leur pertinence spécifique en vertu de critères analytiques déterminés par le projet philosophique. En revanche, un certain empirisme provisoire, raisonné cas par cas, lié à la conduite de recherche discriminante de l’information, fait partie de cet esprit de critique heuristique transdisciplinaire, puisqu’il n’est plus enchaîné d’avance à un type de document consacré et officialisé par la tradition de l’enseignement philosophique, comme c’était en grande partie le cas pour les seuls textes de l’histoire de la philosophie, lesquels ne seraient d’ailleurs nullement éliminés, mais examinés sous la « loupe » de l’analyse de contenu, une analyse comparative, beaucoup plus extensive que l’analyse seulement interne qui en était faite jusqu’alors le plus souvent. Rien n’empêchera, selon cette méthode élargie, de les mettre en perspective avec des textes et des données disparates, hétérogènes, qui pourront appartenir à des champs d’étude contemporains étrangers au domaine institutionnel de la philosophie et de son histoire consacrée, pourvu que l’objectif de la réflexion philanalytique s’en trouve réalisé et si possible enrichi par ces confrontations et croisements documentaires, inhabituels dans l’enseignement scolaire et universitaire de la discipline.
La méthode critique administrée aux données informationnelles de l’univers multimédiatique se veut une méthode pluraliste, régie par le principe semi-empirique d’hybridation conceptuelle des données, mais néanmoins orientée rationnellement par l’analyse de contenu multicritère, qui se définit comme un ensemble diversifié de méthodes heuristiques adaptées, selon les contextes et les objectifs de l’analyse, aux divers types de situations informationnelles rencontrées par le philanalyste de l’information textuelle ou multimédiatique. Le terme « hybridation » ne détient par conséquent aucune connotation péjorative en ce contexte. Il prétend répondre, au contraire, à la diversité des connaissances – certes parfois plus ou moins assurées et inhomogènes – apportées par l’univers foisonnant de l’information qui mixte les champs les plus étrangers les uns aux autres, à la manière d’un puzzle mouvant aux dimensions infinies. Or, le philosophe répugne habituellement à hybrider les domaines hétérogènes du savoir ; il préfère l’idéale homogénéité du concept qui aplanit les aspérités de notre rapport cognitif chaotique, instable et incertain, rhizomique, par capillarité, en un mot : fractal, au monde dont nous faisons partie. La philanalyse critique de l’univers informationnel constitue, probablement, l’un des meilleurs moyens de désenclaver l’institution philosophique, de la faire sortir d’elle-même tout en lui donnant un nouveau ressort, car elle s’instaure grâce à la médiation informationnelle, sans bien entendu s’y réduire. La cyberculture développée par l’utilisation habituelle de l’Internet et des réseaux de données en ligne, se caractérise en premier lieu, en son mode de fonctionnement, par le système de consultation hypertextuel des données informationnelles.
Les hyperliens (ainsi dénommés par analogie avec le terme « hypertexte », inventé en 1965 par le documentaliste-informaticien américain Ted Nelson, auteur d’un très ambitieux projet de bibliothèque informatique) et l’hyperdocumentation (ensemble ouvert des documents multimédias numérisés auxquels accède le consultant par l’hypertextualité) renvoient les uns aux autres en une complexité arborescente disparate, polyphonique et bigarrée, indéfiniment ouverte et sans fond, de « pages-fichiers » numériques. Par la comparaison des données selon la méthode arborescente de l’hypertexte, l’utilisateur de ressources en ligne crée indéfiniment de nouvelles relations entre ces données. À la culture linéaire de la tradition livresque se substitue une culture croisée en réseau, au maillage dense et omnidirectionnel, à une infinité d’entrées, qui est seule capable d’ouvrir l’intelligence au monde du savoir métissé et hybridé que les technologies de l’information permettent de mettre en œuvre. Wikipédia, Twitter et les flux RSS, agrégateurs d’hyperliens[4] – comme d’autres types de réseaux sociaux fédérateurs d’intérêts, à l’instar de Facebook –, les blogs, les sites, les bases de données multimédias, les forums spécialisés (les « newsgroups » de Usenet), etc., fédérateurs de savoirs inachevés, comparatifs et collaboratifs, sont les nouveaux « livres » ouverts, en réorganisation permanente, des savoirs modernes auxquels la philosophie universitaire ne peut manquer de se confronter et surtout de participer, de collaborer.
La culture philosophique classique visait l’établissement d’un savoir totalisant, fondé sur les certitudes de l’universalisme conceptuel qui servait à résorber en son sein n’importe quelle espèce de contenu d’information, « vulgaire » ou bien hypostasié par la tradition historique de la philosophie académique. Au contraire, la culture philosophique « hypermédiatique » ou « hypertextuelle » qui accepte de se placer en interférence active avec la cyberculture, reconnaît à l’exemple documentaire la valeur référentielle primordiale – bien qu’hétéroclite et toujours fragmentaire – à partir de quoi peut se construire une pensée en voie de cohésion progressive, mais provisoire, en mutation potentielle, à la mesure de ce nouvel « universel » sans totalisation ni systématisation rationnelle possibles, qu’envisageait et défendait, à la fin du vingtième siècle, le philosophe Pierre Lévy : « la cyberculture exprime la montée d’un nouvel universel, différent des formes culturelles qui l’ont précédé en ce qu’il se construit sur l’indétermination d’un quelconque sens global.[5] » Sans nier la valeur compréhensive de la conceptualisation, la philosophie ainsi conçue en son apprentissage et son enseignement aurait pour mission d’intégrer en son discours le dissemblable, l’hétéroclite et le disparate informationnel, sous forme de synthèses argumentatives replaçant chaque information ou groupe d’informations (textes, images et/ou documents sonores) sous le projecteur de l’analyse croisée des contenus, afin de pouvoir les comparer, les recouper, les hybrider, les mettre en concurrence avec toute autre information qui serait susceptible de leur procurer, par cet exercice de mise en corrélation, une signification plus complète et qualitativement plus « universelle », ce terme ne signifiant plus du tout un quelconque rapport à l’universalité conceptuelle humaniste, totalisante et éterniste d’antan, mais une recherche permanente et inachevée de signification multidimensionnelle, pour ainsi dire en transhumance philosophique.
En guise de pseudo-conclusion – conclure (fermer, achever) serait forcément contradictoire pour la pensée de la culture informationnelle –, laissons la parole à Michel Serres, dont les réflexions sur l’éducation en mutation de l’ère numérique pourraient être choisies, préférentiellement, comme la « feuille de route » la plus stimulante des apprentis-philosophes du vingt-et-unième siècle : « Ceux dont l’œuvre défie tout classement et qui sèment à tout vent fécondent l’inventivité, alors que les méthodes pseudo-rationnelles n’ont jamais servi de rien. Comment redessiner la page ? En oubliant l’ordre des raisons, ordre certes, mais sans raison. Il faut changer de raison. Le seul acte intellectuel authentique, c’est l’invention. Préférons donc le labyrinthe des puces électroniques.[6] »
[1] On lira avec profit à ce sujet : Michel Serres, Petite Poucette, Paris, éd. Le Pommier, 2012, et Michel Serres, Le Tiers-Instruit, Paris, éd. Bourin, 1991. – Dans un registre apparenté, relatif à la « pensée complexe » et la « dialogique », nous renvoyons également à l’œuvre prophétique et clairvoyante d’Edgar Morin.
[2] Jean-Claude Chirollet, Philosophie et Société de l’information (Pour une philosophie fractaliste), Paris, éd. Ellipses, 1999.
[3] Dans mon livre Philosophie et Société de l’information (Pour une philosophie fractaliste), Paris, éd. Ellipses, 1999, j’expose notamment comment se sont constitués au dix-neuvième siècle les programmes et l’agrégation de philosophie, depuis le philosophe français Victor Cousin (1792-1867) et sa « philosophie éclectique » à laquelle l’esprit de l’enseignement philosophique actuel est toujours redevable.
[4] Rappelons qu’un « agrégateur » est une application informatique (constituée de logiciels ad hoc) qui permet de rassembler (d’agréger) des contenus d’information textuels et multimédias, sous la forme d’hyperliens et de renvois à des sources d’information apparentées, au fil de l’apparition en temps réel de centres d’intérêt auxquels s’abonnent sélectivement les internautes.
[5] Pierre Lévy, Cyberculture, Paris, éd. Odile Jacob / éd. du Conseil de l’Europe, novembre 1997, p. 14.
[6] Michel Serres, Petite Poucette, Paris, éd. Le Pommier, 2012, p. 45.
© Jean-Claude Chirollet